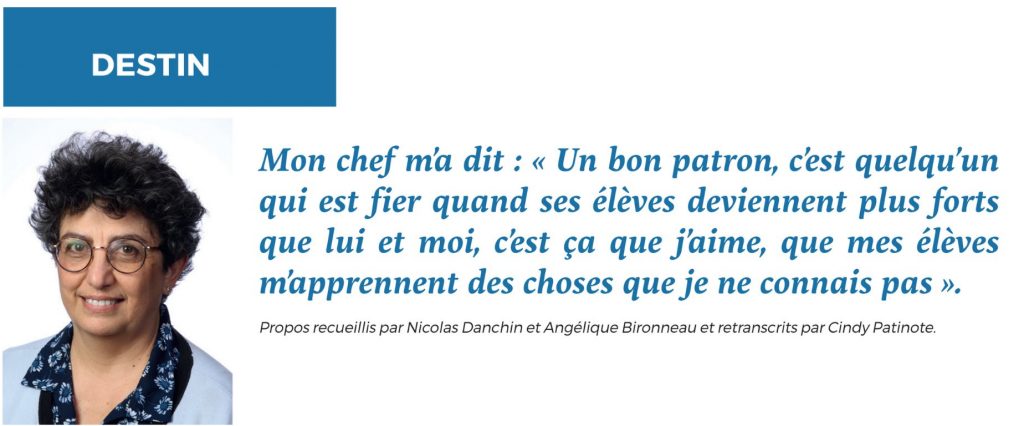
Propos recueillis par Nicolas Danchin et Angélique Bironneau et retranscrits par Cindy Patinote.
INTERVIEW : Tabassome Simon
Missions : Professeur de Pharmacologie Clinique à la Faculté de Santé Sorbonne Université, Praticien Hospitalier, chef de service de Pharmacologie Clinique à l’hôpital St Antoine, elle est également coordinatrice de la Plateforme Recherche Clinique de l’Est Parisien (URC- Est, CRC-Est, CRB) et binôme VP-Recherche à l’APHP avec le Pr Gabriel Steg.
CORDIAM : Qu’est-ce qui a fait que vous vous êtes tournée vers la médecine ?
Tabassome Simon (TS) : C’est une longue histoire. Pendant très longtemps, j’ai hésité entre l’idée de faire des études de philosophie, de sciences politiques ou de médecine. Cela vient de plusieurs rencontres qui ont précédé mes études. J’ai fait mes études d’abord en Iran au lycée français de Téhéran. J’ai été élevée dans une famille d’intellectuels et en particulier ma mère, une journaliste très connue, et j’ai donc baigné dans un milieu où l’on parlait beaucoup de livres, entourée d’écrivains, de philosophes, de poètes, etc… Dans la bibliothèque de mes parents où on était autorisé à lire tous les livres -il n’y avait pas de censure– je suis tombée sur la photo de la couverture d’un livre d’Oriana Fallaci qui a attiré mon attention. Elle devait avoir 45- 50 ans et était reporter de guerre au Vietnam, la photo, très connue et qui a gagné beaucoup de prix, montre un « Viêt-Cong » à genoux, les mains attachées dans le dos, avec un soldat qui tient un fusil, sur le point de le tuer. L’homme était terrorisé et derrière on voyait des enfants qui couraient avec les femmes. Cette photo m’avait beaucoup impressionnée, j’étais très jeune, mais j’ai décidé de lire ce livre, un très gros livre. Je l’ai lu d’une traite durant des nuits entières. Il y a eu un concours à la radio en Iran, pour les enfants et pré- ados, où l’on pouvait choisir d’écrire sur un livre qui nous plaisait. Et j’ai donc postulé, sans dire à ma mère que j’allais y participer. D’autres enfants avaient écrit sur Tarzan ou je ne sais plus quel personnage de conte, des choses que les enfants lisaient et moi j’avais écrit un truc sur la guerre du Vietnam et Oriana Fallaci. J’imagine que cette atypie a fait que j’ai gagné ce concours et pendant la discussion, j’avais donc expliqué pourquoi ce livre m’avait impressionné, cette dualité entre la guerre, les gens blessés, les morts, l’injustice, mais aussi la fascination qu’avait ce reporter pour être sur les terrains de guerre. Et je me souviens que le journaliste m’avait dit « Est-ce que vous préféreriez, dans le futur, être une Oriana Fallaci ou un Albert Schweitzer ? ». J’avais répondu « Non, je voudrais être Tabassome ». Ma mère qui était derrière, écoutait et m’avait souri, contente de ma réponse. Ensuite, on avait discuté et elle m’avait dit « Tu sais, tu as raison, le métier de médecin est formidable, si un jour tu deviens médecin, je serais très contente. Mon père, ton grand père que tu n’as pu connaitre malheureusement, était un grand pharmacien».
CORDIAM : Quel âge aviez-vous à peu près ?
TS : 11 ou 12 ans, je pense. Je me souviens que cette histoire de livres avait presque choqué certains qui avaient d’ailleurs demandé à mes parents comment j’avais pu avoir accès à ce livre car ce n’était pas un livre pour enfant. Ma famille était une famille extrêmement atypique en Iran. À 16 ans, j’ai dit à mes parents que j’avais envie de quitter l’Iran et d’aller aux États-Unis pour faire des études. J’étais en fin de seconde à l’époque et mes parents ne m’avaient pas dit non, alors que ça ne se faisait pas du tout. Que les parents décident d’envoyer seuls leurs enfants dans des pensionnats en Suisse par exemple cela se faisait, mais surtout pour les garçons. Mais que ça soit l’enfant qui lui-même décide et que les parents disent « oui », là, c’était vraiment très atypique. Simplement, le seul hic pour mes parents, c’est qu’ils ne voulaient pas que j’aille aux Etats-Unis parce qu’ils n’aimaient pas l’éducation américaine. Et donc, pour trouver un compromis entre mon souhait et ce qui leur paraissait le plus adapté, ils ont accepté que j’aille à Londres. C’est comme ça que je me suis retrouvée en 1ère au lycée français de Londres, d’autant que le proviseur du lycée français de Téhéran était parti à Londres.
N’ayant plus ma famille près de moi, j’ai lu énormément de livres en philosophie, mais aussi des romans et en particulier des livres de Simone de Beauvoir qui me passionnaient. Un jour, je suis partie en France pour des vacances et je suis immédiatement tombée amoureuse de Paris. J’étais déjà venue à Paris en étant enfant, mais cette fois-ci, j’étais jeune adolescente et seule, et Paris m’a fait l’effet d’un enchantement absolument extraordinaire. L’architecture de la ville, les couleurs, le bruit, les cafés, étaient très différents de Londres (à l’époque, Londres était un milieu très fermé alors que Paris était une ville ouverte). C’était le printemps, et en rentrant à Londres, j’ai décidé de faire mes études à Paris dès l’année suivante. J’ai trouvé moi-même mon lycée et j’ai dit à mes parents que je préférerais vivre à Paris. Là encore, mes parents ont accepté. À ce moment-là, très influencée par la lecture des livres de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, j’ai essayé de les rencontrer, en particulier Sartre. Et donc un jour, je l’ai rencontré (je vous passe les détails) et j’ai eu la chance par la suite d’aller le voir très régulièrement pendant mon année de terminale. J’étais hésitante entre faire médecine ou philosophie. Finalement, voyant la vie devenir de plus en plus compliquée à tous les niveaux, j’ai décidé de faire médecine, en me disant que si j’y allais c’était vraiment dans l’optique de devenir un grand médecin. Voilà comment j’ai commencé médecine l’année précédant la révolution en Iran, en 1978.
CORDIAM : Donc vous vous êtes orientée vers la médecine à ce moment-là ?
TS : Depuis que j’étais petite, je travaillais beaucoup, j’étais très bonne élève et je me souviens encore de mon père qui me disait que je travaillais trop et qu’il fallait que j’aille jouer. Je pense d’ailleurs qu’à cause de ça, ils m’ont fait faire beaucoup de sport. Mais à chaque fois que je faisais du sport, je faisais des compétitions : en natation, en basket,… J’ai fait de l’équitation, du ski, du patinage, et même du hockey sur glace alors que ce n’était pas du tout un sport pour les filles. Mais j’étais un peu garçon manqué, j’étais toujours avec des garçons, je jouais avec eux. Je n’aimais pas du tout les bagarres mais j’adorais l’esprit d’équipe avec les garçons, que je retrouvais moins chez les filles de mon âge, et j’ai toujours aimé les équipes. J’ai même joué au foot alors que ça ne se faisait pas. Je n’avais donc pas peur du concours de médecine, je trouvais que c’était un défi de plus et ça m’amusait plus qu’autre chose.
CORDIAM : À quelle faculté étiez-vous donc à Paris ?
TS : À Saint-Antoine, où je travaille maintenant.
CORDIAM : Donc vos études se sont bien passées ?
TS : Oui et non, la 1ère année j’ai arrêté pendant quelques mois la médecine car c’était pendant la révolution. Mes parents avaient envoyé mes frères et sœurs à Paris pour l’été, mais ils étaient restés par la suite, en raison des évènements qui précédaient la révolution, je me suis retrouvée à devoir m’occuper de mes frères et sœurs qui allaient encore à l’école, et donc quand ma mère a pu me rejoindre à Paris, j’ai craqué et j’ai arrêté mes études pendant plusieurs mois. Je n’ai donc pas passé le concours cette année-là et j’ai recommencé l’année d’après. Bref, le début des études universitaires a été particulièrement dur.
CORDIAM : Pourquoi ce choix de vous tourner vers la pharmacologie plutôt que vers une discipline clinique X ou Y ? Parce que ce n’est pas un choix qui paraît complètement évident.
TS : Surtout pour moi, parce que j’adorais les malades. Je faisais énormément de gardes, quand j’étais externe, plus que les autres. J’avais commencé à faire des remplacements en médecine générale, en ville alors que je n’étais qu’en 6ème année. Très tôt, j’ai commencé à faire ça parce que j’adorais les malades, presque trop : j‘étais trop empathique et je n’arrivais pas à avoir la distance avec les patients et avec leurs histoires. Probablement, encore une fois, parce que je pense que la révolution en Iran m’a beaucoup impactée. J’ai vraiment eu 2 personnalités, une avant et une après. Je me suis mariée très jeune et pour gagner des sous, mon mari, lui aussi étudiant en médicine, participait aux essais de phase I, comme volontaire sain. Je l’accompagnais pour écouter les informations données par Patrice Jaillon sur ces essais. Il était cardiologue, et chef de service de pharmacologie, après une mobilité réalisée à Stanford. Deux choses m’avaient d’emblée soufflée. Il expliquait aux étudiants volontaires sains, tous des garçons, qu’il était passible d’emprisonnement s’il y avait le moindre problème car disait-il les essais étaient illégaux en France. Et donc chacun des étudiants qui participaient à un essai pouvait l’attaquer en justice pour empoisonnement, même s’ils avaient donné leur consentement pour leur participation. Qu’un médecin accepte de se mettre autant en danger, pour faire une recherche, m’avait beaucoup épatée. Je lui avais demandé de participer comme volontaire sain à ses essais, mais il avait refusé en me disant« Ah non, ce n’est pas possible parce que tu es une fille, déjà pour les garçons c’est compliqué mais alors une fille… Tu peux être enceinte, et puis même sans grossesse, les résultats risquent d’être différents en raison des différences hormonales, et puis de toute façon c’est non, je refuserai absolument d’inclure une fille. D’ailleurs personne n’inclut une fille dans un essai de phase I. » Sa réponse me révoltait et je ne la comprenais pas, car les médicaments une fois sur le marché allaient être prescrits aux femmes malades: je ne comprenais pas comment on pouvait évaluer des médicaments uniquement chez les garçons pour ensuite les donner à tout le monde. Je le lui ai dit et je me souviens qu’il a été intrigué par ma question, mais aussi mon audace. Et donc pendant des années, j’ai été attirée par la pharmacologie et la recherche sur les médicaments, mais en même temps j’avais envie de travailler comme médecin en ville, de m’occuper des malades. À l’époque les médecins généralistes faisaient des visites à domicile. Et je trouvais formidable de voir où les gens vivent et comment ils vivent pour mieux comprendre leurs comportements, et les façons de gérer leur prise en charge. Mais en même temps, la recherche, et en particulier d’essayer de comprendre comment les médicaments fonctionnent et comment trouver des médicaments avec un meilleur rapport bénéfice/ risque me semblait passionnant et donc au dernier semestre, je suis allée chez Patrice Jaillon pour faire de la recherche en phase I et là j’ai trouvé que c’était exceptionnel. Il était très accueillant, pédagogue, très ouvert et du coup je suis restée à travailler dans son service. Je n’avais aucun plan de carrière, strictement aucun, d’ailleurs il m’avait salariée avec une association de loi 1901 pour rester dans le service. Et puis un jour, plusieurs années après, durant une réunion de pharmacologie, j’ai rencontré Alain Berdeaux, pharmacologue à Kremlin-Bicêtre. Patrice Jaillon faisait de la pharmacologie cardiologique clinique, et Alain Berdeaux du fondamental. Je me suis dit qu’il serait intéressant d’apprendre davantage et de faire le DEA qu’organisait A. Berdeaux. J’ai demandé à Patrice Jaillon s’il y voyait un inconvénient et il m’avait répondu : « je ne vois pas à quoi ça va te servir parce que les DEA c’est pour ceux qui souhaitent des carrières hospitalo-universitaires et tu n’es pas partie là-dedans, mais fais-le, si tu veux ». Je donnais des cours déjà depuis plusieurs années à l’Université alors que je n’avais aucune fonction hospitalo-universitaire, et bien que travaillant à l’hôpital, je n’étais pas statutaire et payée par une association.
CORDIAM : Vous n’étiez pas cheffe de clinique ou autre ?
TS : Non du tout, et ça ne me venait même pas à l’esprit. Les gens pensaient que j’étais folle parce que je n’avais aucun plan de carrière. Le DEA, c’était vraiment par curiosité intellectuelle. Je me suis donc inscrite et j’ai été major du DEA.
CORDIAM : Et quel était votre sujet ?
TS : les polymorphismes génétiques D2-D6 pour le dextrométhorphane et leur lien avec les allongements de QT. Alain Berdeaux m’a demandé si j’allais faire une thèse de sciences après. Le DEA m’avait beaucoup plu, même si mon véritable intérêt c’était la pharmacologie clinique, et non fondamentale. À l’époque, il n’y a pas vraiment de thèse en pharmacologie clinique. J’en ai discuté avec Patrice Jaillon, quelques années après le DEA. Je m’intéressais aux différences de genre et de sexe, et je pense que là, c’est un peu mon héritage de mes lectures philosophiques car à l’époque la différenciation entre genre et sexe n’était pas du tout un sujet en France, notamment en médecine, encore moins les questions sur le pronostic de maladie, ou des effets des médicaments selon le sexe. L’idée des effets du médicament selon le sexe remontait à l’époque où j’avais voulu faire partie des volontaires sains, en 3ème année de médecine. L’idée de travailler sur les œstrogènes m’est venue un jour où Patrice Jaillon m’a dit qu’il y avait un financement possible par un laboratoire, en me demandant si j’avais une idée de recherche. Justement, j’avais envie de faire un essai sur les effets du THS sur l’intima-media carotidienne et la rigidité artérielle. J’avais eu cette idée après un cours de Stéphane Laurent au DEA sur la rigidité artérielle et l’intima-média carotidienne et les effets des médicaments. Patrice Jaillon était un patron exceptionnel : non seulement il ne s’est pas accaparé l’idée, mais il m’a emmenée voir le laboratoire avec le projet qu’il m’avait encouragée à écrire. Nos interlocuteurs étaient très intéressés, mais le projet était chiffré à plus d’un million de dollars, un budget qui nécessitait l’accord de la maison-mère aux USA. Là encore, il n’a pas voulu y aller seul, mais nous sommes allés à trois, Stéphane Laurent, Patrice Jaillon et moi, pour présenter le projet chez Pfizer à New York. Et on a obtenu ce financement. J’ai donc poursuivi la recherche sur ce sujet et j’ai passé ma thèse, là encore par curiosité, je ne cherchais pas à avoir un poste statutaire. Par la suite, à l’occasion d’un congrès de pharmacologie, Alain Berdeaux m’a suggérée de postuler pour un poste hospitalo-universitaire en dehors de St-Antoine. Ça parait probablement étonnant, mais cette idée ne m’avait pas traversée l’esprit, je n’avais pas envie de partir, de par la complicité que j’avais avec P. jaillon et la liberté d’action qu’il m’offrait. Un jour Patrice m’a dit une chose : « Un bon patron c’est quelqu’un qui est fier quand ses élèves deviennent plus forts que lui-même et moi disait il, j’aime que mes élèves m’apprennent des choses que je ne connais pas ». Je voyais les autres patrons qui n’étaient pas du tout dans cette philosophie de travail, je voulais donc rester travailler avec lui. C’est ce que j’ai répondu à Alain Berdeaux qui a été très surpris par ma réponse et en a parlé à Patrice. J’imagine que c’est cela qui a lui donné l’idée d’envisager une carrière hospitalo- universitaire pour moi dans son service.
CORDIAM : En fait, ce qui vous a toujours intéressée dès le départ, ce sont les études de pharmacologie clinique ?
TS : Ce ne sont pas les dosages ni les études de pharmacovigilance, non. En fait, le rapport bénéfice/ risque in fine, c’est ça qui m’intéressait et forcément dans le domaine cardiologie puisque c’était au départ la thématique du service.
CORDIAM : La cardiologie, c’était circonstanciel parce que c’était le domaine de Patrice Jaillon ? Car vous n’auriez pas été contre aller vers la cancéro, la pneumo ou un autre domaine ?
TS : J’imagine que s’il avait fait de la neuro, j’y serais allée. Je serais malhonnête de dire que c’était la cardiologie qui me passionnait au départ. Parce que quand j’étais externe, je trouvais toutes les spécialités passionnantes. J’étais en gynéco où j’ai adoré l’obstétrique, j’étais en cardio chez Jean Acar à Tenon et c’est là où j’ai connu Alec Vahanian qui démarrait dans le service les premiers essais d’angioplastie primaire et je me souviens que je prenais tout le temps des gardes à l’USIC. J’ai adoré cette époque-là. Mais je m’interessais à toutes les disciplines. Lorsque j’étais aux urgences en pédiatrie, j’ai adoré la pédiatrie, et même la chirurgie m’avait plu. C’était un peu comme quand j’étais au lycée, tout me passionnait, je n’avais pas de préférence dans une matière en particulier. Tout me plaisait. C’était peut-être pour ça que la coordination d’une unité de recherche clinique telle que, URC de l’Est Parisien, était quelque chose que je pouvais faire, parce que je m’intéressais à toutes les pathologies, ça ne me dérangeait pas du tout d’y travailler pour essayer d’aider les uns et les autres, même si ma recherche était en cardiologie.
CORDIAM : Pouvez-vous expliquer en 2 mots ce que vous faites pour l’ensemble des disciplines, car c’est transversal l’URC.
TS : Ah oui, c’est un travail extrêmement transversal, parce que mon rôle et le rôle de l’équipe de manière générale c’est d’aider tous les médecins et paramédicaux, de notre groupe hospitalier ou dans d’autres hopitaux de l’APHP qui nous sollicitent à réaliser leur recherche. Les cliniciens viennent avec une idée de projet et on les aide à ce que cette idée devienne un protocole, en travaillant ensemble sur sa conception (rationnel, méthodologie, faisabilité, réglementaire, etc), à l’obtention d’un financement, grâce aux soumissions à des appels d’offres, notamment ceux des programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) ou les appels d’offres européens ; mais aussi via des financements par des associations, des fondations, ou des partenariats avec l’industrie, etc. Une fois les autorisations réglementaires obtenues par le promoteur de l’essai, le plus souvent APHP pour les études académiques, nous coordonnons en lien avec avec le chercheur la logistique et l’ensemble des opérations cliniques de l’étude, y compris les aspects data-management, monitoring avec les ARCs,… Nos biostatisticiens analysent les données en lien avec les investigateurs et on les aide dans l’écriture de l’article et les réponses aux reviewers. On intervient donc de la conception du projet jusqu’à la publication des résultats.
CORDIAM : Les URC existent depuis 2002 : vous avez commencé dès 2002 à vous occuper de l’URC de Saint-Antoine ?
TS : Oui avec Patrice Jaillon. Mais pas uniquement à Saint Antoine. En fait, avant même la mise en place des groupements hospitaliers de l’APHP, on avait commencé à travailler avec l’ensemble des hôpitaux qui étaient sur notre faculté.
CORDIAM : Combien de personnes travaillent dans votre URC aujourd’hui ?
TS : Actuellement, plus de 200 personnes travaillent dans la plateforme de recherche clinique que je coordonne, la plateforme inclut l’URCEST mais aussi un centre de ressources biologiques pour les fluides mais aussi le microbiote (CRB-BARM) et un centre de recherche clinique (CRC). Mais évidemment, à côté de ce travail, ma passion a été la recherche en cardiologie et donc j’ai continué évidemment à le faire avec Patrice Jaillon. Puis, j’ai eu la chance de rencontrer Nicolas Danchin, vers 2001 ou 2002, grâce à une amie commune, qui un jour m’a dit « mais comment est-ce possible que tu ne connaisses pas Nicolas Danchin ? ». Je pense qu’elle lui avait dit la même chose de son côté ! Ça a été pour moi un coup de foudre amical et de complicité de travail absolument exceptionnel, un peu comme ce que j’avais déjà avec Patrice Jaillon. Notre premier travail ensemble a été de regarder les différences de prise en charge et de pronostic entre les hommes et les femmes après un infarctus du myocarde. Ça a été joyeux : non seulement il y avait de la rigueur, et du travail, mais Nicolas Danchin a cette particularité, je pense assez unique, de faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Et ça, ça m’enchantait vraiment et ça continue de m’enchanter. Moi j’étais trop sérieuse, un peu rigide et lui il était très ensoleillé et ça me plaisait beaucoup. Et puis sur le plan amical j’avais l’impression qu’on partageait beaucoup de choses en commun, on avait la même passion de la recherche, on avait la même vision sur beaucoup de choses et très vite on est devenu très amis. Quand il a voulu développer son registre d’infarctus, je l’ai influencé un peu sur certaines idées, d’abord d’aller chercher de l’argent de manière – je ne sais pas comment l’expliquer – de manière plus agressive, peut-être. Et aussi d’essayer d’étudier davantage les médicaments et notamment de récolter les informations sur les traitements non-cardiovasculaires pour étudier leur impact éventuel. Je lui ai également conseillé de faire une bio-banque dans son registre qui paraissait vraiment difficile à réaliser, compte tenu du nombre de centres, du nombre de malades inclus en un mois et donc de très nombreux prélèvements journaliers à recevoir et à traiter. Je lui ai dit que je m’en occuperais alors que je n’avais pas l’expérience d’une étude de cette envergure-là auparavant. On avait bien sûr déjà géré des prélèvements dans le cadre de nos essais de phase I ou II en pharmacologie, mais jamais à une telle échelle. Mais le travail que nous avons fait dans FAST m’a énormément apporté, mais aussi à lui je pense. Car cela a bien marché et on a pu travailler sur le clopidogrel ensemble, avec lui, Laurent Becquemont, Céline Verstuyft, qui étaient pharmacologues à Saint- Antoine avant d’aller à Kremlin-Bicêtre, et avec qui j’avais déjà fait plusieurs études en pharmacogénétique. On s’est intéressé aux effets sur la survenue d’événements cliniques après un infarctus de certaines enzymes, génétiquement déterminées, impliqués dans le métabolisme, le transport, et la cible du clopidogrel. On a réussi, après beaucoup de péripéties, à publier les résultats de ce travail dans le New England Journal of Medicine ; Il n’était pas fréquent d’avoir des résultats issus de registres publiés dans le New England, encore moins des registres de la Société Française de Cardiologie. C’était typiquement un travail d’équipe, et ça a été une joie profonde et une fierté pour tous ceux grâce à qui ce travail a pu se réaliser.
CORDIAM : Pourriez-vous nous dire un mot sur la manière dont l’éditeur associé du NEJM, John Jarcho, a géré la publication du papier ?
TS : En fait ma vie est faite de rencontres, et chacune de ces rencontres m’a enrichie, pas seulement dans le travail, mais de manière personnelle et John Jarcho est une des personnes qui a été également très importante dans ma vie. Le papier sur le clopidogrel avait au départ été refusé, parce qu’on n’avait pas de réplication de nos résultats, ce qui est toujours un souci avec les études de pharmaco-génétique, où le risque de trouver des résultats purement liés au hasard existe réellement. Mais cela me semblait tellement dommage que j’ai osé appeler John Jarcho, que je ne connaissais absolument pas à l’époque, et j’ai réussi à le convaincre, non pas que le papier soit accepté mais qu’on ait une chance de lui expliquer pourquoi ce papier méritait d’être revu. Tout le monde me disait que j’étais folle de l’appeler, que ça n’allait pas marcher, et que, si on un papier était refusé au New England on n’avait aucune chance d’être repris. J’ai appelé malgré tout et John Jarcho m’a dit plus tard que jamais les gens ne lui avaient parlé comme je l’avais fait : il avait été intrigué et avait bien voulu qu’on lui envoie notre argumentaire pour en discuter au comité éditorial du journal qui a in fine décidé de publier l’article. Mais à partir du moment où il a accepté, John m’a renvoyée plus de 100 questions, 103 je crois, pour éclaircir certains points. Ça montre à quel point John Jarcho était un éditeur engagé ; pour moi il a été pratiquement un co-auteur très important du papier. Et j’ai appris par la suite qu’il travaillait comme ça sur tous les papiers de cardiologie du NEJM ; je ne sais pas s’il posait 103 questions pour chaque article, mais en tout cas il s’investissait totalement, mieux qu’un co-auteur, dans chacun des papiers publiés, meme si son nom n’y apparait pas. Par la suite, une amitié profonde nous a liés tous les deux, et on profitait de l’opportunité des congrès de cardiologie pour se voir et discuter des heures, et pendant le reste de l’année quand on était chacun dans notre coin, on s’écrivait souvent, sur la vie, nos enfants, nos conjoints, nos familles, les lectures, le cinéma, etc… Et là encore, on avait beaucoup de choses en commun. on parlait beaucoup ensemble de tout, y compris de la recherche, des médicaments et de ce qu’était l’intégrité dans le travail, la rigueur, beaucoup de politique aussi parce qu’il était démocrate et s’intéressait énormément à la politique comme moi, donc il m’éclairait sur la façon dont les Américains voyaient les choses. Nous sommes restés proches jusqu’au dernier moment parce qu’il est décédé malheureusement d’un cancer il n’y a pas très longtemps. Je suis allée le voir à Boston, 15 jours avant sa mort et là encore il m’a impressionné car il continuait à s’intéresser à la vie comme toujours, tout en sachant parfaitement qu’il allait mourir dans les semaines à venir. J’ai eu une chance inouïe de l’avoir comme ami. Et si on veut mieux connaitre la personne qu’il était, il faut lire ce très bel éditorial publié dans le nejm suite à son décès, par ses collègues du journal.
CORDIAM : Qu’est-ce qui a marqué votre parcours plus récent ?
TS : La connaissance et le travail avec Nicolas Danchin et Gabriel Steg a fait qu’un jour, je pense qu’on était dans le métro avec Nicolas, je leur ai proposé de créer un réseau de recherche clinique en cardiologie, pour essayer de mettre ensemble des centres intéressés pour pouvoir faire des essais cliniques et aussi pour être moteur pour des plus jeunes, pour les aider comme d‘autres m’avaient aidée quand j’ai démarré. Ils y pensaient aussi tous les deux je pense, sans en parler. C’est comme ça qu’on a créé tous les trois le réseau FACT (French Alliance for Cardiovascular Trials), qui est labellisé par Fcrin. Le démarrage a probablement été facilité par le succès de FAST, le fait que Nicolas Danchin avait déjà réussi à fédérer les cardiologues de tous les centres en France, pour un projet commun. C’était une fois tous les 5 ans évidemment mais il y avait déjà cet esprit d’équipe, cet esprit d’ouverture, cet esprit de dire « venez tous, pour proposer des idées de recherche, et écrire les papiers et les publier ». C’est cet esprit- là que je trouvais extraordinaire de faire perdurer et le réseau dans mon esprit était ça, d’essayer de faire en sorte qu’on puisse travailler ensemble sur des essais, bien sûr sur des registres aussi si besoin. Par son talent et son travail, Gabriel Steg a été, et est toujours, la très grande locomotive pour attirer les essais internationaux pivots en France. On a donc pu faire plusieurs essais internationaux de renom mais aussi des PHRC qui ont été portées par des plus jeunes, que ça soit Etienne Puymirat, Gilles Lemesle, Gilles Baronne-Rochette et d’autres. Ensuite, on a pu déposer un RHU, ensemble là encore, avec Gabriel Steg, dans lequel le réseau intervient de manière très importante. Le RHU nous a permis de mettre en place, grâce à l’expertise de Nicolas Danchin sur FAST, le registre « Frenchie » dans lequel on a pu, pour la première fois pour un registre d’infarctus, chaîné les données recueillies lors de l’hospitalisation initiale des patients inclus avec les données du SNDS et donc de permettre d’évaluer leur prise en charge grâce aux informations sur la consommation de soins. Par ailleurs, on a réussi à nicher dans le registre des essais cliniques ; plusieurs sont en cours et certains sont terminés. Il y a eu aussi beaucoup d’autres projets. Par exemple, l’essai REALITY, porté par Grégory Ducrocq et financé par la DGOS grâce à un appel d’offres national PRME, qui a évalué deux stratégies de transfusion sanguine chez des patients qui ont fait un infarctus et qui avaient une anémie. Les résultats de l’essai ont été publiés dans le JAMA et on a pu enchaîner avec une participation française sur le même thème dans l’essai MINT, un essai financé par le NIH, dont les premiers résultats ont été publiés dans le New England l’année dernière. Il y a eu, et il y a encore, beaucoup de projets à partir de la bio-banque de FAST-MI en lien avec les chercheurs au PARCC, Ziad Mallat et Hafid Ait Oufella, notamment pour étudier l’influence des biomarqueurs sur le pronostic de l’infarctus, en essayant de déterminer s’il s’agissait d’une simple association ou bien d’une relation causale, avec des études de randomisation mendélienne. À la suite des collaborations avec Ziad Mallat, nous avons bâti ensemble l’essai de phase II RITA-MI, financé par un appel d’offres européen, qui évalue l’effet protecteur éventuel du rituximab administré au stade aigu de l’infarctus. C’est un essai promu par l’APHP que nous coordonnons et qui se déroule dans plusieurs pays européens dont la France bien sûr, où il est porté par le réseau FACT. Je pense sincèrement que FACT est une réussite, et qu’on peut être fier de ce qu’on a fait, j’ai l’impression que les membres de FACT sont heureux d’y être et j’espère qu’après nous ils continueront de le faire fructifier, de l’améliorer, de l’enrichir etc. Et il y a encore une chose dont j’aimerais en dire quelques mots : il s’agit du Master de recherche clinique que j’ai créé il y a quelques années. Il n’y en avait pas auparavant, en dehors de ceux davantage portés sur les problématiques de Santé Publique, mais qui n’étaient pas à mon sens vraiment des masters de recherche clinique. J’ai donc créé un Master de recherche clinique, avec 2 parcours à Sorbonne Université avec le soutien de notre doyen, Bruno Riou : un premier parcours destiné aux pharmaciens et les biologistes qui veulent faire un métier en lien avec la recherche clinique, que ça soit en R&D, affaires réglementaires, affaires médicales ou pharmacovigilance ; et un deuxième parcours pour les médecins, pour leur faire connaitre toutes les caractéristiques et étapes de la recherche clinique, de la conception du projet jusqu’à la publication des résultats, dans lequel on a créé avec Gregory Ducrocq, Etienne Puymirat et Johanne Silvain un module spécifique de recherche en cardiologie. C’est ce type de Master que j’aurais aimé pouvoir suivre en étant jeune. C’est merveilleux de voir que Michel Zitouni, un ancien étudiant du master, va remplacer, à partir de cette année, Johanne Silvain en raison de ses nouvelles fonction de chef de service à la Pitié Salpétrière.
CORDIAM : Avez-vous des regrets particuliers en regardant rétrospectivement votre carrière ?
TS : J’ai toujours eu une profonde affection pour les malades, et je me rends compte que mes positions sont souvent plus cliniques que celles de certains cliniciens. Je me concentre sur l’impact final pour le patient : est-ce que cela va vraiment les aider ? Je suis surprise que ceux qui parlent constamment de « leurs » malades n’y pensent pas autant. Je regrette de ne pas pouvoir suivre des patients et participer à la prise en charge de leur maladie. Cela me manque, soigner les malades est un métier extraordinaire, et je pense avoir été un bon clinicien. Je me console en me disant que ce que je fais aujourd’hui aide indirectement les patients et contribue à leur mieux-être.
CORDIAM : Comment voyez-vous le futur ?
TS : Sur le plan pratique, je constate un vrai manque de culture en recherche clinique en France. Bien que nous ayons accompli des choses, nous restons globalement moins intéressés que d’autres pays. C’est peut-être dû à notre incapacité, en tant qu’universitaires, d’expliquer l’importance cruciale de cette recherche. En voyant les communications catastrophiques en France relayées par certains liées au Covid, notamment Didier Raoult, j’ai réalisé que nous avions échoué à expliquer l’importance de la recherche clinique. J’ai même la sensation douloureuse que l’adhésion de l’opinion publique vis-à-vis des essais cliniques a même régressé, malgré l’exploit réalisé par les chercheurs de la mise à disposition d’un vaccin efficace dans des délais si rapides et tous les progrés réalisés dans de nombreuses pathologies grâce aux données des essais cliniques. Autrefois, les concepts de nouveaux médicaments venaient souvent d’Europe, mais leur développement et succès se faisaient aux États-Unis. Aujourd’hui, la concurrence mondiale est rude, et pour rester compétitifs, il faut collaborer, surtout au niveau européen. En Europe, le manque de phases précoces dans le développement de médicaments est alarmant. Nous avons de nombreux problèmes de réglementation complexe. Si certaines règles sont absolument nécessaires pour protéger les patients et les volontaires sains, d’autres sont absurdes et inutiles, freinant sérieusement notre compétitivité internationale. La réglementation doit évoluer, notamment en décentralisant et utiliser la digitalisation dans les essais thérapeutiques pour diminuer au maximum les contraintes liées à la recherche. L’IA sera utile dans certains domaines, mais pas tous. L’essentiel est de combiner des données massives de qualité pour obtenir des informations plus précises grâce au numérique. Pour progresser, il faut que les patients deviennent de véritables partenaires de la recherche. C’est, selon moi, la meilleure façon d’avancer.
